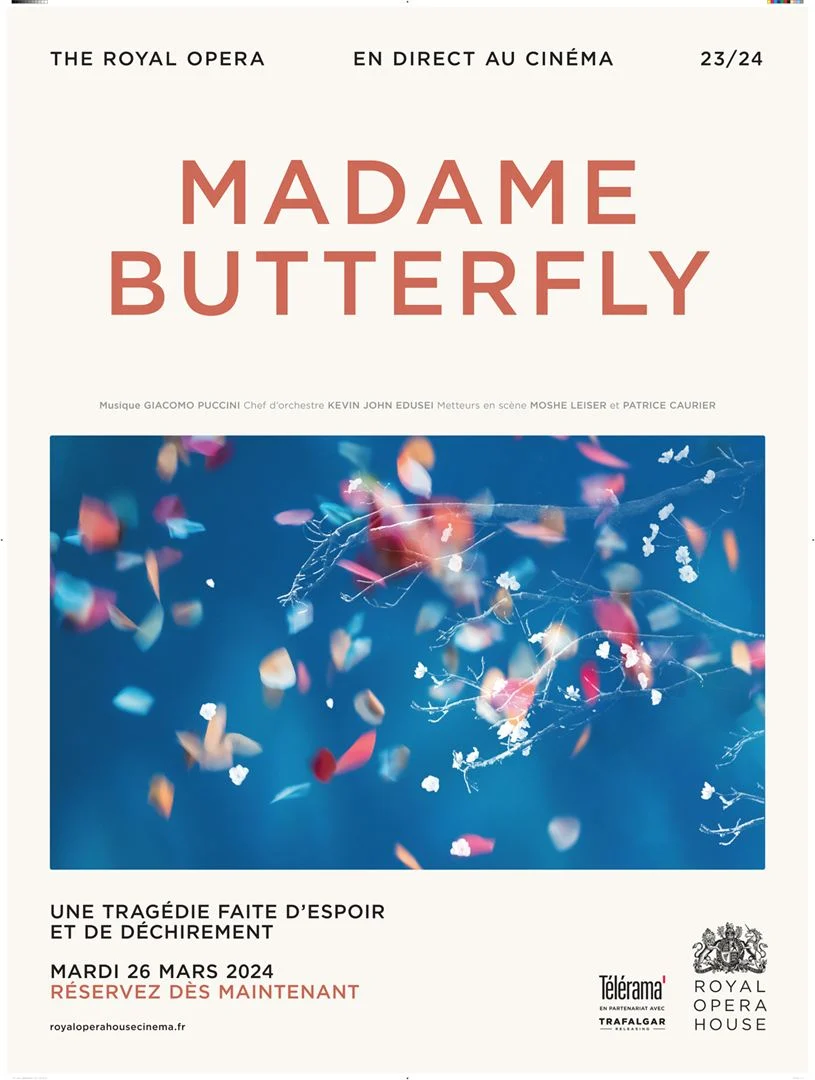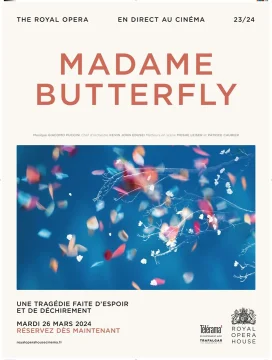Les retransmissions cinématographiques (la plupart en direct et quelques-unes en différé) des grands théâtres du monde et plus particulièrement du Royal Opéra House de Londres, du Metropolitan Opera de New-York et de l’Opéra de Paris constituent, depuis un certain nombre d’années, une véritable institution.
Plusieurs réseaux de salles de cinéma proposent d’ailleurs un abonnement pour une saison complète, à l’instar des théâtres. On ne peut bien sûr que s’en réjouir puisqu’il s’agit là de remplir nombre d’objectifs parmi lesquels de permettre à certains mélomanes qui n’ont pas les moyens de voyager, de mettre les grands évènements lyriques à leur portée et à proximité et peut-être par ailleurs de vulgariser l’opéra à destination de ceux qui n’osent pas toujours franchir le seuil des théâtres qui programment ce répertoire, considérant qu’il s’agit d’un univers quelque peu « ésotérique » et enfin de satisfaire les fans qui bien qu’habitués des salles d’opéra, veulent néanmoins embrasser un plus grand nombre de représentations, d’autant que dans certaines contrées celles-ci ne cessent hélas de s’amoindrir pour, la plupart du temps, des contraintes budgétaires.
Le cinéma a également d’autres vertus : celle d’une parfaite visibilité et celle d’utiliser les gros plans qui mettent en lumière l’interprétation de certains artistes devenus désormais de véritables acteurs et actrices du fait de l’évolution de l’art lyrique en plus d’un demi-siècle par l’émergence d’éminents metteurs en scène de théâtre ou de cinéma ayant donné corrélativement naissance à une nouvelle génération de « chanteurs-acteurs ». On vient aujourd’hui, évidemment, toujours à l’opéra pour y entendre des voix et de la musique – incontestablement vecteurs puissants d’émotions – mais pour se trouver de surcroît, transporté par une interprétation – au sens plein de ce terme – en ce siècle où le théâtre comme le cinéma sont les miroirs effectifs d’une vérité fondée sur la vie même. Le « réel » ayant supplanté le « factice ».
De ce point de vue, et pour illustrer nos propos, le choix de Madama Butterfly n’apparaît pas anodin.
Nous avons pu voir cette œuvre sur scène successivement aux Arènes de Vérone en septembre 2023, puis à l’Opéra de Nice et au Théâtre Anthéa Antibes au mois de mars 2024. La retransmission au cinéma de la production du Royal Opera House de Londres constitue un moyen excitant de se pénétrer à nouveau – par la confrontation avec une représentation scénique – de l’œuvre de Giacomo Puccini, sans doute l’une des plus populaires du répertoire lyrique (et comme nous l’écrivions récemment : « l’enfant chéri (e) » du compositeur ).
En outre, le rôle de Madame Butterfly (ou plus justement celui de Cio-Cio-San, nom exact de la protagoniste) se singularise par le fait d’occuper en permanence la scène dès la quinzième minute de l’ouvrage.

Par ailleurs, ce choix s’impose de surcroît, au regard de l’interprète principale, en l’occurrence Asmik Grigorian. Il apparaît fort intéressant de comparer la prestation de la soprano lituanienne d’abord dans l’une des plus grandes enceintes de plein air (celle des Arènes de Vérone comportant plus de 20.000 places) et ensuite, dans celle d’une salle de théâtre (au Royal Opera House) via une retransmission sur grand écran. Ni les conditions, ni les perceptions ne sauraient être identiques entre des arènes et une salle de spectacle « fermée », qui restera assurément le lieu privilégié pour une multitude de raisons qu’il semble inutile ici de développer, tant elle ne peut qu’emporter la conviction des amateurs d’art lyrique. Le cinéma instaure une 3ème voie.
Et pourtant… installé dans notre fauteuil devant le grand écran il ne nous a pas échappé quelques sanglots – à peine retenus – entendus dans les rangs voisins preuve que l’opéra, quels que soient les modes de son écoute et les modalités de son approche, se révèle comme l’extraordinaire véhicule émotionnel que nous évoquions ci-dessus.

La Cio-Cio-San d’Asmik Grigorian est en effet tout simplement exceptionnelle (existe-t-il d’autres termes tant les mots que nous pourrions employer paraîtraient galvaudés?). A Vérone (il s’agissait en cette année 2023 du centenaire de cette institution) la scénographie luxuriante et somptueuse (peut-être trop ?) de Franco Zeffirelli adaptée à l’immense plateau des Arènes reconstitue tout un quartier de Nagasaki au pied d’une colline colossale dans laquelle se trouve quasiment incrustée la demeure de Cio-Cio-San qui ressemble davantage à un palais qu’à l’humble maisonnette décrite dans le livret. En ce lieu vont et viennent une multitude de figurants, touristes, marins en bordée, autochtones, passants, jeunes femmes aguichantes, musiciens ambulants, domestiques, transporteurs, boutiquiers divers, serviteurs etc. L’histoire de la pauvre geisha se trouve quelque peu étouffée par ce luxe de détails !
Et pourtant, sans doute par sa voix et son génie interprétatif (bien qu’encadrée par les contraintes d’une mise en scène dont le classicisme ne peut être bousculé) Asmik Grigorian avait donné une interprétation particulièrement émouvante de la jeune adolescente japonaise qui finit par se sacrifier par désespoir d’amour. Mais comment percevoir la multitude d’expressions tant dans ses gestes et plus encore sur son visage lorsqu’on se trouve installé sur un gradin à des distances qui ne permettent pas pareille perception ?
Toujours est-il que ce rendez-vous demeurera mémorable et que nous garderons dans notre souvenir un détail qui reste caractéristique de pareille soirée. Lorsque Asmik Grigorian sortant des Arènes, longea l’immense Piazza Bra où se situe en arc de cercle une multitude de restaurants, les clients se levèrent au fur et à mesure sur son passage pour lui réserver une ovation. On ne voit évidemment pas pareil événement tous les jours même de mémoire d’amateur d’art lyrique assidu !…

Le cinéma offre donc une toute autre vision et bien que la mise en scène de Moshe Leiser et de Patrice Caurier parfaitement connue (depuis plus de deux décennies et de multiples éditions au Royal House Opera de Londres) ait fait l’objet de diffusions notamment via la télévision, il n’en demeure pas moins que l’on éprouve un réel plaisir à la contempler sur grand écran lequel restitue beaucoup mieux que les petites « lucarnes » de nos demeures les dimensions d’une scène.
Mais elle permet surtout – comme nous le soulignions en liminaire – de saisir la moindre expression du visage des protagonistes.
Les metteurs en scène ont choisi une scénographie relativement sobre fondée sur des estampes japonaises et toute l’action se déroule à l’intérieur de la maison de Butterfly constituée en tout et pour tout que par des panneaux qui montent et qui descendent au gré de l’action et qui permettent par, intermittence, de découvrir en fond soit la baie de Nagasaki soit les arbres en fleurs du jardin (c’est totalement l’inverse par exemple de la production des Arènes de Vérone ou celle plus récente de l’Opéra de Nice ou de bien d’autres productions qui privilégient l’extérieur). Cette scénographie signée Christian Fenouillat accentue l’enfermement de Cio-Cio-San entre ses quatre murs et justifie, si besoin était, l’attente fiévreuse de l’héroïne du retour de Pinkerton.

L’unité de lieu donne ici à l’opéra de Puccini un aspect particulièrement théâtral à l’instar d’une tragédie. Dans les murs clos d’une seule pièce Cio-Cio-San épouse Pinkerton, passe une nuit d’amour avec lui, puis malgré la misère, élève son enfant, alterne l’espoir de l’attente avec la déception du retour, et enfin s’y donne la mort ce qui accentue la concentration du spectateur essentiellement sur le jeu des artistes. Cet univers en lieu clos fait la part belle aux protagonistes à l’identique de la focale d’une caméra de cinéma, s’attardant sur les gros plans.
Somme toute, et connaissant son impressionnante palette interprétative, pareille scénographie convient idéalement à Asmik Grigorian qui ne cesse au cours de sa brillante carrière de se confronter à des emplois aussi différents que ceux de Rusalka, Salomé, Chrysothemis (dans Elektra), Senta dans Le Vaisseau fantôme, Lisa dans La Dame de Pique, Tatiana dans Eugène Oneguine, Turandot, et bien entendu, les trois rôles du Triptyque de Puccini1 (Lauretta de Gianni Schicchi, Giorgetta du Tabarro et Suor Angelica) etc. Son interprétation de la jeune geisha demeure de bout en bout d’un naturel et d’une sobriété exemplaires dénuée de tout « maniérisme folklorique ». Là où d’autres cantatrices s’astreignent à accentuer, pour des raisons (erronées) de (prétendue) crédibilité, les gestes et manières des japonaises la cantatrice parvient avec un naturel confondant à traduire le caractère universel – et non fragmentaire – de la femme éprise, trahie puis conduite à l’accomplissement du sacrifice suprême en une séquence bouleversante. Par une admirable simplicité de jeu elle rend le personnage d’autant plus passionnant. En fait, cette Cio-Cio-San là, n’a ni âge, ni nationalité : elle est ici la féminité même poussée à son paroxysme.

De surcroît, nous avons retrouvé dans cette version filmée les qualités vocales qui sont celles entendues soit en concert (lors de son récital Tchaïkovski et Rachmaninov au Festival d’Aix-en-Provence), soit dans les ouvrages lyriques (comme le Triptyque de Puccini et Macbeth au Festival de Salzbourg) : la technique souveraine, l‘émission d’une pure clarté, l’homogénéité impeccable de la ligne, la superbe couleur pure et moirée du timbre, le lyrisme enivrant, le souffle inépuisable, les aigus puissants, le médium consistant et les notes graves de toute beauté. S’y rajoute une étendue de la tessiture d’une homogénéité absolue des forte au pianissimi avec, en sus, la souplesse inouïe d’un legato magistralement maîtrisé. Il convient de souligner que son art de dire accompli qui n’appartient qu’aux plus éminentes tragédiennes lyriques, parvient ainsi à susciter une profonde émotion et ce, avec une incroyable économie de moyens. Voici une cantatrice qui atteint des sommets grâce à une introspection miraculeuse, en maniant un art sublime du phrasé et un sens unique de chaque mot. Difficile de décrire avec des termes adéquats ses crescendos incroyables tout comme le lyrisme qu’elle déploie tant ils sont hors du langage commun.
Aux côtés de cette Cio-Cio-San d’anthologie s’inscrit une distribution d’une indéniable valeur où chacun des artistes se révèle parfaitement convaincant, ce qui parait indispensable face aux dons prodigieux de l’héroïne.

Joshua Guerrero (le partenaire d’Asmik Grigorian dans Le Tabarro du Triptyque de Puccini à Salzbourg ) évite d’incarner le monolithique Pinkerton que l’on nous sert habituellement sous la seule emprise de l’attirance sexuelle pour l’adolescente, n’exprimant seulement qu’au dernière acte des regrets aussi tardifs que vains. Ici se dessine un personnage beaucoup plus ambigu et partagé dans ses états d’âme avec même une part de doute voire de fragilité. D’un point de vue vocal, on entend une voix ample de ténor lyrique dotée de moyens parfois presque trop avantageux pour l’écriture du rôle. On pense, par moments, à Del Monaco ou Corelli. L’interprète s’attache néanmoins à certaines nuances bienvenues.

Le Sharpless de Lauri Vasar fait preuve d’une élégance théâtrale et vocale qui rend attachant ce consul toujours préoccupé d’attirer l’attention de Pinkerton sur les véritables sentiments de Cio-Cio-San.
Dans cette production les interprètes des rôles japonais sont tous des asiatiques, ce qui ôte le caractère « artificiel » lorsque des artistes occidentaux en ont la charge. Physiquement l’excellente Suzuki de Hongni Wu s’accorde parfaitement avec une Cio-Cio-San dont elle pourrait être la sœur (quelquefois le rapport avec des Suzuki plus âgées s’avère moins intéressant). Il en va de même pour le Goro de Ya-Chung Huang particulièrement cauteleux et sournois et le prince Yamadori de Josef Jeongmeen Ahn.
Une mention pour le bonze particulièrement incisif de Jeremy White. Kate Pinkerton est interprétée par Veena Akama-Makia.

Il faut insister sur tout ce que la remarquable mise en scène de Moshe Leiser et Patrice Caurier et leur direction d’acteurs apportent à l’œuvre de Puccini. L’élément fondamental réside en ce que la retransmission cinématographique s’inscrit dans une totale vraisemblance : à ce point ce pourrait être un film tourné pour la circonstance. Car il faut bien avouer que d’autres productions moins réussies passent très mal l’épreuve de la retransmission et mieux vaut alors voir les interprètes d’un regard plus lointain, celui que l’on porte au théâtre avec la distance nécessaire. En effet l’écran de cinéma ne pardonne rien et grossit le moindre défaut. Ici rien ne choque parce qu’au-delà de leur prestation vocale les chanteurs se révèlent parfaits comédiens.
Si les yeux sont particulièrement satisfaits, l’oreille n’est pas en reste, car outre les voix on se délecte avec le somptueux orchestre du Royal Opera House. Il est vrai que l’une des plus belles phalanges lyriques du monde bénéficie en la circonstance de la baguette du maestro Kevin John Edusei qui semble totalement pénétré par l’œuvre de Puccini, témoin le magnifique interlude entre l’acte 2 et 3 qui se joue à rideau baissé, ce qui permet à la caméra de s’attarder à loisir sur des musiciens talentueux et tout particulièrement sur un chef aussi charismatique qu’investi.
Un moment magique où le cinéma relaie avec intelligence et efficacité l’opéra pour le mettre à la portée de tous.
Christian Jarniat
Retransmission cinématographique du 26 mars 20242
1 Le triptyque de Puccini dans la production du Festival de Salzbourg sera à l’affiche à l’Opéra de Paris la saison prochaine (du 29 avril au 28 mai 2025).
2 Certains cinémas retransmettent encore cette production de Madama Butterfly au cours de ce mois d’avril.
Direction Musicale : Kevin John Edusei
Metteur en scène : Moshe Leiser et Patrice Caurier
Responsable de la reprise : Daisy Evans
Décors : Christian Fenouillat
Costumes : Agostino Cavalca
Lumières : Christophe Forey
Distribution
Cio-Cio-San : Asmik Grigorian
Lieutenant BF Pinkerton : Joshua Guerrero
Sharpless : Lauri Vasar
Goro :Ya-Chung Huang
Suzuki : Hongni Wu
Le Bonze : Jeremy White
Le prince Yamadori : Josef JeongmeenAhn
Kate Pinkerton : Veena Akama-Makia
Orchestre du Royal Opera House
Chœur du Royal Opera House
Royal Opera House London: Cinematic Broadcast of Madama Butterfly with Asmik Grigorian from Stage to Screen.
Several cinema chains also offer a subscription for a full season, much like theatres do. One can only welcome this development as it achieves numerous objectives, including allowing some music lovers who cannot afford to travel to access major lyrical events locally and possibly to popularise opera among those who might not always dare to step into theatres that schedule this repertoire, considering it to be somewhat of an « esoteric » world, and finally, to satisfy fans who, although regular opera-goers, wish to experience a greater number of performances, especially since in some regions, unfortunately, these are decreasing, most often due to budgetary constraints.
Cinema also has other virtues: that of perfect visibility and the use of close-ups that highlight the interpretation of certain artists who have now become true actors due to the evolution of the lyrical art over more than half a century through the emergence of eminent theatre or cinema directors, consequently giving rise to a new generation of « singer-actors ». Today, one obviously still goes to the opera to hear voices and music – undeniably powerful vectors of emotion – but also to be transported by an interpretation – in the full sense of the term – in a century where theatre as well as cinema are the effective mirrors of a truth based on life itself. The « real » has supplanted the « artificial ».
From this perspective, and to illustrate our point, the choice of Madama Butterfly is not trivial.
We were able to see this work on stage successively at the Verona Arena in September 2023, then at the Nice Opera and the Anthéa Theatre Antibes in March 2024. The cinematic broadcast of the Royal Opera House production in London provides an exciting means to immerse oneself anew – through confrontation with a stage performance – in the work of Giacomo Puccini, arguably one of the most popular in the lyrical repertoire (and as we recently wrote: « the darling child » of the composer).
Furthermore, the role of Madam Butterfly (or more accurately, that of Cio-Cio-San, the protagonist’s exact name) is distinguished by her constant presence on stage from the fifteenth minute of the piece.
Moreover, this choice becomes all the more compelling when considering the main performer, namely Asmik Grigorian. It proves most intriguing to compare the performance of the Lithuanian soprano first in one of the largest open-air venues (that of the Verona Arena, seating over 20,000) and then, in a theatre setting (at the Royal Opera House) through a broadcast on the big screen. Neither the conditions nor the perceptions can be identical between an arena and an « enclosed » performance space, which will surely remain the favoured venue for a multitude of reasons that seem unnecessary to elaborate here, as it can only convince lovers of lyrical art. Cinema introduces a third path.
And yet… seated in our chair in front of the big screen, we could not miss a few sobs – barely held back – heard in the rows nearby, proving that opera, regardless of the ways it is listened to and the approaches to it, reveals itself as the extraordinary emotional vehicle we mentioned above.
Asmik Grigorian’s Cio-Cio-San is indeed simply exceptional (are there other terms when the words we might use seem trite?). In Verona (in the year 2023, marking the centenary of this institution), the lush and lavish (perhaps overly so?) stage design by Franco Zeffirelli, adapted to the immense space of the Arena, reconstructs an entire district of Nagasaki at the foot of a colossal hill, into which Cio-Cio-San’s dwelling, more resembling a palace than the humble cottage described in the libretto, is almost embedded. In this place, a multitude of extras, tourists, sailors on leave, locals, passers-by, enticing young women, itinerant musicians, servants, carriers, shopkeepers, and servants etc., come and go. The story of the poor geisha is somewhat smothered by this abundance of detail!
And yet, perhaps through her voice and interpretative genius (although framed by the constraints of a staging whose classicism cannot be disrupted), Asmik Grigorian had given a particularly moving performance of the young Japanese adolescent who ultimately sacrifices herself in despair of love. But how can one perceive the multitude of expressions in her gestures and even more so on her face when seated on a tier at distances that do not allow such perception?
Be that as it may, this appointment will remain memorable, and we will keep in our memory a detail that remains characteristic of such an evening. When Asmik Grigorian left the Arena, walking along the vast Piazza Bra where a multitude of restaurants are situated in a semicircle, customers stood up as she passed by to give her an ovation. Such an event is obviously not seen every day, even in the memory of a dedicated opera art enthusiast!…
Cinema, therefore, offers a wholly different vision, and although the staging by Moshe Leiser and Patrice Caurier, well-known for over two decades and numerous editions at the Royal Opera House in London, has been broadcast via television, there remains a genuine pleasure in viewing it on the big screen, which better captures the dimensions of a stage than the small « portholes » of our homes.
But, more importantly – as we highlighted in the introduction – it allows one to catch every subtle expression on the protagonists’ faces.
The directors chose a relatively sober set design based on Japanese prints, and the entire action takes place inside Butterfly’s house, which is entirely comprised of panels that rise and fall according to the action and allow, intermittently, a view of either Nagasaki bay or the blooming trees in the garden (this is totally opposite, for example, to the production at the Verona Arena or the more recent one at the Nice Opera or many other productions that favor outdoor settings). This set design by Christian Fenouillat emphasizes Cio-Cio-San’s confinement within her four walls and justifies, if need be, the heroine’s feverish waiting for Pinkerton’s return.
The unity of place here gives Puccini’s opera a particularly theatrical aspect, akin to a tragedy. Within the enclosed walls of a single room, Cio-Cio-San marries Pinkerton, spends a night of love with him, then, despite her poverty, raises their child, alternates between hope and disappointment over his return, and finally commits suicide there, which focuses the audience’s attention primarily on the performers’ acting. This confined setting showcases the protagonists similarly to the focus of a cinema camera, lingering on close-ups.
All in all, and knowing her impressive interpretative range, such a set design ideally suits Asmik Grigorian, who continues throughout her brilliant career to tackle roles as varied as those of Rusalka, Salome, Chrysothemis (in Elektra), Senta in The Flying Dutchman, Lisa in The Queen of Spades, Tatiana in Eugene Onegin, Turandot, and of course, the three roles in Puccini’s Trittico (Lauretta in Gianni Schicchi, Giorgetta in Il Tabarro, and Suor Angelica), etc. Her portrayal of the young geisha remains from start to finish naturally and exemplarily restrained, devoid of any « folkloric mannerism ». Where other singers might strain to accentuate, for reasons (mistakenly) of (supposed) credibility, the gestures and manners of Japanese women, this singer manages with astonishing naturalness to convey the universal – not fragmentary – character of a woman in love, betrayed, then driven to the act of supreme sacrifice in a moving sequence. Through her admirable simplicity in acting, she makes the character all the more fascinating. In fact, this Cio-Cio-San has neither age nor nationality: she is femininity itself, taken to its extreme.
Furthermore, in this filmed version, we found the vocal qualities that are heard either in concert (during her Tchaikovsky and Rachmaninov recital at the Aix-en-Provence Festival) or in lyrical works (like Puccini’s Trittico and Macbeth at the Salzburg Festival): supreme technique, emission of pure clarity, impeccable homogeneity of the line, superbly pure and nuanced timbre, intoxicating lyricism, inexhaustible breath, powerful high notes, solid mid-range, and beautifully deep low notes. Added to this is a range of tessitura of absolute homogeneity from forte to pianissimi, with, moreover, the incredible flexibility of a masterfully controlled legato. It should be emphasized that her accomplished art of expression, which only the most eminent lyrical tragediennes possess, thus manages to evoke deep emotion, and this, with an incredible economy of means. Here is a singer who reaches heights through miraculous introspection, wielding a sublime art of phrasing and a unique sense of each word. It’s difficult to describe with adequate terms her incredible crescendos and the lyricism she unfolds, as they are beyond common language.
Alongside this anthological Cio-Cio-San is a cast of undeniable value where each of the artists proves perfectly convincing, which seems essential given the prodigious talents of the heroine.
Joshua Guerrero (Asmik Grigorian’s partner in Il Tabarro from Puccini’s Trittico at Salzburg) avoids embodying the monolithic Pinkerton that is usually presented to us, driven solely by sexual attraction to the teenager, only expressing late and futile regrets in the final act. Here, a much more ambiguous character emerges, divided in his feelings, with even a hint of doubt and fragility. Vocally, we hear a rich lyric tenor voice with capabilities sometimes almost too grand for the role’s writing. At times, one is reminded of Del Monaco or Corelli. Nevertheless, the performer pays attention to certain welcome nuances.
Lauri Vasar’s Sharpless displays a theatrical and vocal elegance that makes this consul, always concerned with drawing Pinkerton’s attention to the true feelings of Cio-Cio-San, endearing.
In this production, the performers of the Japanese roles are all Asians, which removes the « artificial » nature often present when Western artists take on these roles. Physically, the excellent Suzuki of Hongni Wu matches perfectly with a Cio-Cio-San she could be the sister of (sometimes the relationship with older Suzukis proves less interesting). The same goes for the particularly cunning and deceitful Goro of Ya-Chung Huang and Prince Yamadori of Josef Jeongmeen Ahn.
A mention for the particularly incisive Bonze of Jeremy White. Kate Pinkerton is played by Veena Akama-Makia.
It is crucial to emphasize everything that the remarkable staging by Moshe Leiser and Patrice Caurier and their direction of actors bring to Puccini’s work. The fundamental element lies in the fact that the cinematic broadcast is completely plausible: to such an extent, it could be a film shot for the occasion. It must be admitted that other, less successful productions do not fare well in transmission, and it is then better to view the performers from a more distant perspective, the one taken in the theatre with the necessary distance. Indeed, the cinema screen is unforgiving and magnifies the slightest flaw. Here, nothing is jarring because, beyond their vocal performance, the singers prove to be perfect actors.
If the eyes are particularly satisfied, the ears are not left wanting, for in addition to the voices, one delights in the sumptuous orchestra of the Royal Opera House. It is true that one of the finest lyrical ensembles in the world benefits on this occasion from the baton of maestro Kevin John Edusei, who seems completely immersed in Puccini’s work, as evidenced by the magnificent interlude between acts 2 and 3 played with the curtain down, allowing the camera to linger at leisure on talented musicians and particularly on a conductor as charismatic as he is committed.
A magical moment where cinema intelligently and effectively relays opera, making it accessible to all.
Christian Jarniat
Cinematic broadcast of the 26th of March, 2024.