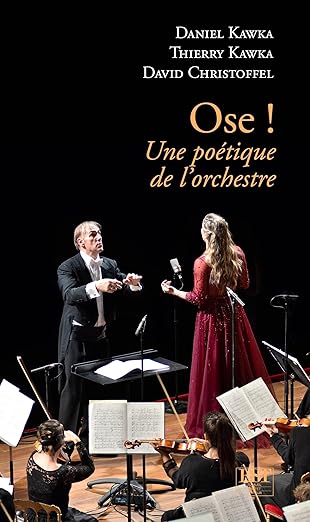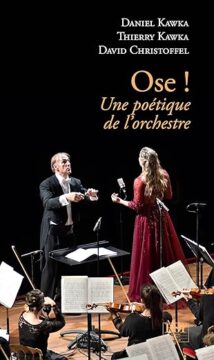Daniel Kawka, avec ses équipiers Thierry Kawka et David Christoffel, signe un livre décapant et d’une grande richesse, marqué au coin d’une intelligence aiguë. Il honore un artisanat qui – contrairement à celui loué par le poète René Char – n’a rien de furieux. Où l’on suit les chemins de la démocratisation de la musique classique, parfois obstrués par des fâcheux et leurs obligés.
*****
Voici un demi-siècle, la formation intellectuelle générale de certains chefs d’orchestre laissait réellement à désirer. Mais le rayonnement de Pierre Boulez (1925-2016) provoqua des changements indéniables de braquet parmi la corporation. D’ailleurs, l’ouvrage « Ose ! Une poétique de l’orchestre », cosigné par Daniel Kawka, David Christoffel et Thierry Kawka, est dédié à la mémoire de ce géant de la musique, ayant fasciné entre autres Ernest Fleischmann (1924-2010), le légendaire directeur général de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles. Non sans raison. En dépit de l’obstination d’aucuns, nostalgiques d’un ordre ancien de l’esthétique et contempteurs par principe du système dodécaphonique de Schönberg, l’approche de l’art des sons aura connu l’avant et l’après-Boulez.1 En témoignent les écrits du triumvirat Daniel Kawka, David Christoffel et Thierry Kawka. Ils comportent une dizaine d’éléments conséquents de réflexion, dont un chapitre voué au travail sur l’imaginaire.
Daniel Kawka, le premier des auteurs, est un chef français aux activités internationales bien connu, attaché à son département natal de la Loire, autant qu’un explorateur de répertoires divers dont émerge son intérêt prononcé pour Berlioz, Mahler, Wagner et Strauss. Il aura ainsi donné, avec la soprano Helena Jununten, une impressionnante scène finale de « Salomé » pendant un concert au Victoria-Hall de Genève. Le même Kawka est aussi très engagé en faveur de la musique dite d’avant-garde. David Christoffel a les qualifications de poète et de compositeur. Il a également obtenu un doctorat en musicologie auprès de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), là où vit le souvenir de l’éminent sociologue Pierre Bourdieu (1930-2002). Ce dernier aura acquis une large célébrité grâce à son ouvrage « La Distinction ». Il y aura montré que le poids des origines sociales pèse fortement sur les pratiques culturelles de l’ensemble de la population. Quant à Thierry Kawka, il aura été le bras séculier de l’Orchestre symphonique Ose ! crée par son père Daniel et s’étant déployé de 2013 à 2023. Les missions de Thierry y furent variées. Il aura géré la structure en termes d’administration comme d’organisation et assumé sa logistique, autant qu’effectué des activités de médiation. Celles-ci auront suscité l’ouverture des répétitions au public.
Ces indications sont indispensables dans la mesure où la planète orchestrale ne fonctionnera plus jamais comme à l’époque où Richard Wagner rédigea son traité de direction, avant qu’Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Sergiu Celibidache, Günter Wand ou Erich Kleiber montrent une main de fer dans les rapports avec les instrumentistes soumis à leur férule. Sous ce rapport, les mots suivants de Daniel Kawka sont éclairants : « La vision autocratique du chef d’orchestre […] est révolue. » Outre Daniel Kawka, notre temps dispose de maestri qui, comme Sir Simon Rattle ou Theodor Currentzis sont des figures d’un type nouveau. D’ailleurs, l’intelligence du livre « Ose ! » ne réside pas seulement dans des propos tenus à trois voix à l’intérieur d’un énoncé unifié, mais aussi dans la libre parole accordée aux membres de la formation. Six d’entre eux s’expriment au long du livre. Ils sont respectivement altiste, clarinettiste, corniste, timbalier, tubiste et violoniste. Leurs propos sont tout sauf convenus. L’un d’eux met le doigt sur « l’égoïsme mal placé » d’une partie de leurs camarades d’autres phalanges. En revanche, Ose ! aura montré des préoccupations différentes. Ses membres – tous désignés par leur prénom – y auront travaillé parmi un environnement professionnel élevé, amical et respectueux. En aura résulté une expérience collective inhabituelle, s’étant déroulée dans des conditions où artistes et individus fusionnaient sans grands obstacles.
Dès lors, le terme de « poétique de l’orchestre » se substitue à des considérations relevant du seul management et des finances. Ce vocable entretient peut-être un lien de parenté avec « Poésie pour pouvoir », œuvre de Pierre Boulez écrite sur un texte d’Henri Michaux (1899-1984) et portée sur les fonts baptismaux en 1958.2 Quoi qu’il en soit, la création, tout comme la défense et l’illustration de la musique actuelle, aura été au nombre des éphémérides d’Ose ! Daniel Kawka aura proposé des exécutions de partitions signées du Français Gilbert Amy (*1936), de l’Américain John Adams (*1947), du Libanais Béchera el-Khoury (*1957) ou encore du Suisse Michael Jarrell (*1958). En matière discographique, Kawka et sa phalange auront illustré le prophète Berlioz et réalisé un CD magistral voué au « Marteau sans maître » de Boulez couplé avec « B-Partita » de Philippe Manoury (*1952), chef-d’œuvre écrit en mémoire du même Boulez. Un tel enregistrement montre des exécutants et un chef d’un vrai niveau international.3
Le chapitre consacré au son dans l’ouvrage est foisonnant. On y apprend que le premier contact de Daniel Kawka avec celui-ci prit la forme d’une guitare électrique : « J’entretenais une relation physique avec le son. » Une pareille approche rappelle que les voies d’accès à la direction ne sont plus forcément les parcours académiques de jadis. Une différence culturelle s’impose par comparaison avec le chemin d’une figure comme Charles Munch (1891-1968), ayant d’abord été violoniste.4 De son côté, Daniel Kawka cherchera à parcourir « des crêtes inexploitées » afin de pouvoir « créer un son d’orchestre spécifique » sans commune mesure avec les standards séduisant des esprits aux ressources limitées. Cette quête débute très tôt, au cours de l’apprentissage du métier. Ici réside une différence de taille avec les curriculums imposés parmi divers établissements d’enseignement musical ayant été dominés par une vision conservatrice. On citera, parmi nombre d’autres, tel conservatoire à rayonnement régional encore inféodé – voici près de deux décennies – aux théories désuètes de Marcel Landowski (1915-1999).
Les nouvelles générations ignorent les combats d’une violence inouïe ayant opposé pendant un demi-siècle Boulez à Landowski pour arriver au contrôle de la vie musicale française.5 Ce Chemin des dames connut de sanguinaires explosions quand la question de la pédagogie était abordée. Le premier des deux compositeurs était ouvert à Frank Zappa (1940-1993), avec lequel il se produisit, le second maudissait les coloris orchestraux issus de la seconde École de Vienne. Mais Boulez a vaincu. Landowski est devenu un souvenir pour érudits. Bis repetita placent : la question du son, chère à Daniel Kawka, aura été l’une des composantes de ces escarmouches. En dépit de la précarité des conditions dans lesquelles Ose ! répétait – centres d’accueil, foyers ou salles polyvalentes –, son directeur artistique ne renonça jamais à cette préoccupation fondamentale. Il en fut de même pour l’Ensemble Intercontemporain qui, en dépit de la célébrité internationale de Boulez, passa deux décennies à vivre la transhumance, à l’image des Hébreux dans le désert. Il eut, entre autres, le Théâtre du Rond-Point ou la Cité internationale du boulevard Jourdan comme lieux de répétitions.
Les informations apportées par « Ose ! » n’exonèrent pas le lecteur de la prise de conscience de la toile de fond commune à Ose ! et à l’Ensemble Intercontemporain. Ils ont changé – avec quelques autres ensembles français et étrangers – la vision de l’orchestre, qu’il soit de chambre ou caractérisé par une mer de pupitres. Leurs responsables ne se sont pas laissé décourager et intimider par les attaques parfois empoisonnées en provenance de la planète Landowski. Dans ce combat, les Modernes ont terrassé les grincheux. Ils continuent à briser les séparations doctrinales obsolètes entre types de musique.6 Daniel Kawka l’aura montré en collaborant avec le Rhino Jazz Festival, implanté à Saint-Chamond, commune de 25. 000 habitants située dans la vallée du Gier. Il en aura été de même durant les Léman Lyriques Festivals conduits par ses soins. Le but global de ces entreprises ? « Déconstruire les préjugés autour de la musique classique », à une époque où elle continue à s’effacer dans la conscience culturelle des Français.
Une iconographie soignée, ainsi que la liste des programmes, des solistes invités comme la soprano Petra Lang, le ténor Torsten Kerl, le baryton Vincent Le Texier ou le regretté pianiste Nicholas Angelich (1970-2022) et des membres d’Ose !, accompagnent cette belle publication, évitant de tomber dans le rapport d’activités sec et dans le bilan sous forme d’autosatisfecit. Il fallait oser !
Dr. Philippe Olivier
Daniel Kawka, Thierry Kawka et David Christoffel : Ose ! Une poétique de l’orchestre, Est-Samuel Tastet, 2025, 222 pages, 20 €.
1 Je ne comprends pas, sous ce rapport, qu’un homme aussi informé qu’Yves Riesel (*1958) – le rédacteur du magazine hebdomadaire en ligne « Couacs info » – soit envahi depuis des lustres par une aversion manifeste à l’endroit du phénomène boulézien.
2 Telle une chrysalide, « Poésie pour pouvoir » engendrera « Répons » – l’un des chefs-d’œuvre absolus de Boulez – joué pour la première fois dans sa version d’origine au cours du Festival de Donaueschingen 1981.
3 Sont aussi au nombre des enregistrements d’Ose ! les deux concertos pour piano de Ravel confiés au virtuose Vincent Larderet. La discographie complète de la formation peut être consultée sur www.orchestre-ose.com.
4 Charles Munch : « Je suis chef d’orchestre », Le Conquistador, Paris, 1954.
5 Philippe Olivier : « Pierre Boulez – Le maître et son marteau », Hermann, Paris, 2005. On lira aussi le récent ouvrage de Maryvonne de Saint-Pulgent : « Les musiciens et le pouvoir en France – De Lully à Boulez », Gallimard, Paris, 2025.
6 On lira avec profit la chronique de Michel Guérin dans « Le Monde » du 12 juillet 2025. Elle s’intitule « Paris animée, Paris désordonnée ».