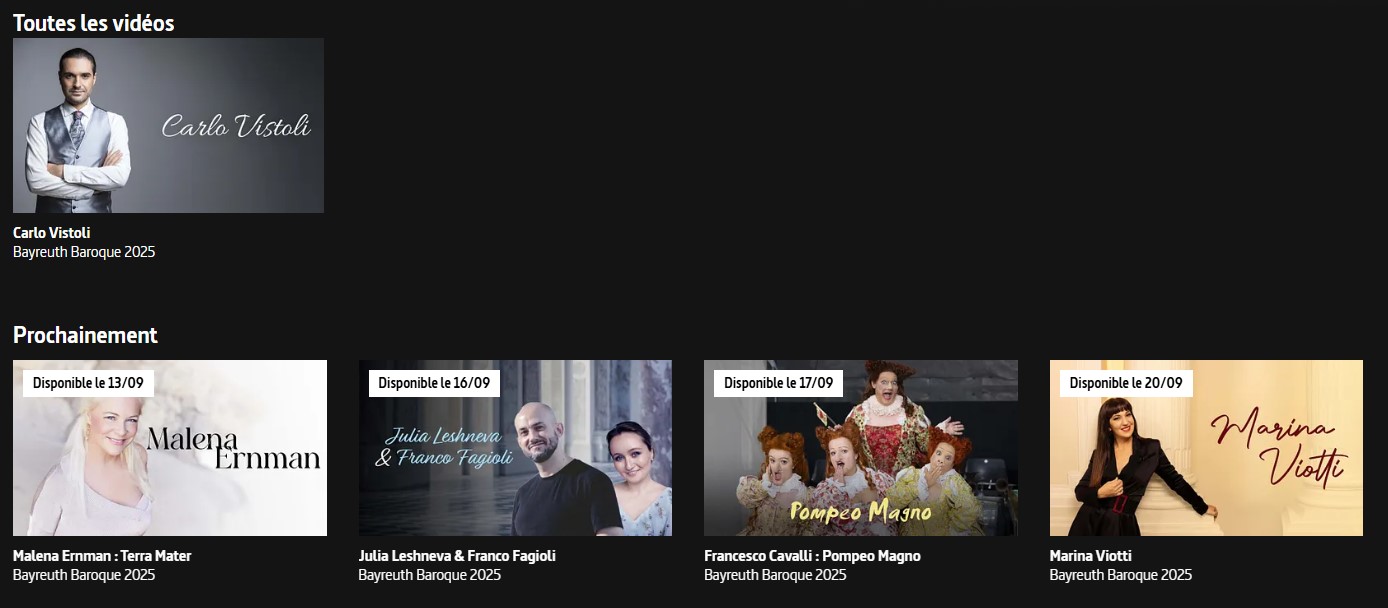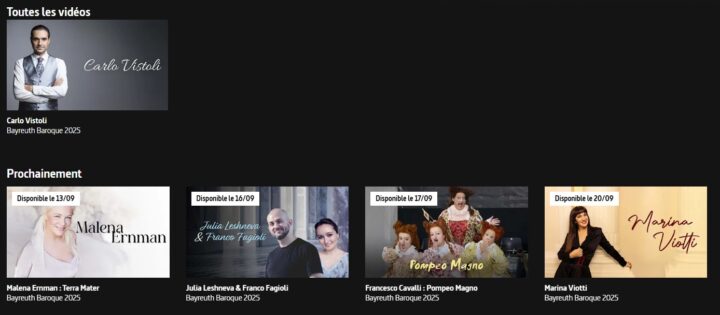« Le XXIème siècle sera sans aucun doute un siècle Cavalli. »
Leonardo García–Alarcón
Pour sa sixième édition, le Festival Bayreuth Baroque revient charmer un public de mélomanes avertis dans le cadre exceptionnel de l’Opéra des Margraves, entré en 2012 au patrimoine mondial de l’humanité, avec en point d’orgue du festival 2025 une nouvelle production de Pompeo Magno de Francesco Cavalli.

Créé en 1666 au Teatro San Salvatore de Venise, Pompeo Magno est le troisième des six opéras à sujets historiques romains de Francesco Cavalli, dont la série constitue les six derniers opus lyriques de Cavalli : Scipione Affricano, Muzio Scevola, Pompeo Magno, Eliogabalo, Coriolano, Massenzi, tous opéras dont la force dramaturgique de ses opéras est essentiellement basée sur le récitatif. Pompeo Magno n’a, en fait, d’historique que le nom.
Si le sujet de l’opéra est emprunté à l’histoire romaine, il est surtout une éblouissante comédie d’intrigues et de malentendus. Le livret est de la plume du très prolifique poète, librettiste et impresario bergamasque Nicolò Minato (1627-1698) qui fit carrière à Venise, de 1650 à 1669, et à Vienne, de 1669 jusqu’à sa mort. On lui doit plus de 200 livrets, surtout viennois. Sept d’entre eux furent écrits pour Cavalli.
Pompeo Magno fut joué en Italie jusqu’à la fin du 17ème siècle, pour ensuite disparaître des scènes. Sa redécouverte est due à l’initiative conjointe du chef argentin Leonardo García–Alarcón, le spécialiste mondial de Cavalli, dont l’ambitieux projet est de ressusciter les 27 opéras conservés du compositeur, et du metteur en scène Max-Emanuel Cenčić, qui est également l’interprète du rôle-titre. Pompeo Magno représente un sommet de l’histoire naissante de l’opéra, mêlant avec virtuosité tous les éléments de l’art lyrique de l’époque pour créer un drame dense et riche en nuances.
L’intérêt pour les opéras de Cavalli n’est pas nouveau. Son œuvre est conservée à la Biblioteca nazionale Marciana (Bibliothèque de Saint-Marc) de Venise. Le problème c’est qu’ils n’ont pas été tous publiés et qu’en amont de la production de ses opéras, il y a un important travail d’édition à effectuer. En 1931, le musicologue français Henry Prunières (1886-1942) appelait déjà ce travail de ses vœux dans son ouvrage consacré à Cavalli :
Ce grand musicien trop oublié nous apparaît avec sa force évocatrice et expressive, sa fougueuse imagination, son sens décoratif, sa vigoureuse sensualité, sa puissance dramatique comme une sorte de Tintoret de la Musique. Mais tandis qu’il nous suffit d’entrer dans un musée pour admirer les toiles rayonnantes de ce grand artiste, il nous faut aller, la plume à la main, chercher dans les partitions de la Marciana les traces du fulgurant génie qui les a créées. Il est pourtant des opéras comme Giasone, Ercole Amante, Scipione Africano, Pompeo Magno… qui pourraient renaître pour notre joie. Quel bienfaisant magicien délivrera la Musique enfermée dans les belles reliures dorées de la Marciana ? Qui saura la rappeler de son long sommeil et la fera sortir à la lumière, tel dans La Virtù dei Strali d’Amore, Meonte délivré des enchantements des sorcières ?

80 ans après la formulation de ce souhait, le bienfaisant magicien s’est enfin matérialisé en la personne de Leonardo García–Alarcón, un chef spécialiste de la musique italienne du Seicento qui fonda l’orchestre baroque de la Cappella Mediterranea en 2005. Il se vit consacré au Festival d’Aix-en-Provence 2013 avec sa direction de l’Elena de Cavalli. Il fit ensuite ses débuts au Palais Garnier en 2016 avec son Eliogabalo du même compositeur. En 2017 il dirigea Il Giasone au Grand Théâtre de Genève et L’Erismena à nouveau à Aix-en-Provence. Elena et Il Giasone ont fait l’objet d’un DVD. On lui doit aussi un CD avec la Cappella Mediterranea et Marianna Flores intitulé Francesco Cavalli. Heroines of the venitian baroque.
Le grand général Gnaeus Pompée (Pompeo Magno) est revenu victorieux à Rome après sa troisième campagne de conquête et est célébré comme un héros par les grands du royaume ainsi que par César lui-même. Mais il n’est pas temps de se reposer sur ses lauriers, car à la cour romaine, loin du vacarme des batailles, des combats secrets faits d’amour, de désir, de trahison et de jalousie se déroulent à huis clos : Sesto, le fils de Pompeo, convoite la belle prisonnière de guerre Issicratea, sans savoir qu’elle est l’épouse de Mitridate, adversaire de son père et que l’on croyait mort. Mais Mithridate est vivant et se trouve incognito à Rome, où il met à l’épreuve la fidélité de son épouse et la loyauté de son fils Farnace. Pompeo, de son côté, est tombé amoureux de Giulia, la fille de César, qui a cependant déjà promis son cœur à Servilio. Le redoutable conquérant devra ainsi se prouver également en tant qu’homme…

L’action de Pompeo Magno se déroule à Venise, dans laquelle tragédie et comédie se côtoient et les émotions profondes alternent avec des scènes grotesques pleines d’esprit. Max Emanuel Cenčić met en scène cet univers foisonnant de personnages et de couleurs issu du joyeux et exubérant esprit du carnaval et de la Commedia dell’arte, avec une inventivité et une énergie débordantes. En 1666, date de la création de l’opéra, Venise approchait de la fin de la guerre de Candie, qui dura 25 ans. Les Turcs cherchaient à conquérir la Crète, alors sous domination de la République de Venise, alors une grande puissance méditerranéenne. Ils y parvinrent trois ans plus tard. Cette atmosphère de guerre a pu inspirer Pompeo Magno qui oscille entre rêve et réalité. La mise en scène associe avec beaucoup de subtilité le personnage de Pompée à celui du Doge de Venise. Le passé se mêle au présent dans une histoire où les intrigues secondaires, le plus souvent comiques, prennent nettement le pas sur l’évocation historique. À titre d’exemple, le triumvirat de Pompée, Crassus et César n’est évoqué que dans un récitatif qui tient sur une seule page.

La scénographie d’Helmut Stürmer place l’action dans un palais vénitien comme celui du Ca’ Rezzonico, auquel le programme emprunte le motif de la fresque des Pulcinellas. Pulcinella, notre polichinelle, est ce personnage de la Commedia dell’arte coiffé d’un bonnet blanc, portant un masque noir qui couvre la moitié du visage, avec un nez crochu rappelant la forme d’un bec. On retrouve dans le décor les fenêtres en ogive vénitiennes et l’emblématique lion ailé et la nécessaire ouverture du palais sur le canal. Pompeo y arrive dans une gondole d’apparat. Plus avant, le fond de scène montrera la lagune ou se verra paré d’une de ces fresques mythologiques qui décoraient les plafonds des palais ou des opéras, comme celui de la Margrave à Bayreuth.

La mise en scène bouillonne d’extravagance et de lubricité : Max Emanuel Cenčić nous plonge dans la folie populaire du carnaval vénitien, une période où tout semble permis sous le couvert des déguisements. La scène pullule de nains en habits de pulcinella et de naines en robes fleuries dépoitraillées comme des prostituées. Les nains étaient un des topos du carnaval. Non loin de Venise les concepteurs de la Villa Valmarana ai Nani, construite à l’époque du Pompeo Magno. avaient dispersé 17 sculptures de nains dans les jardins, pour par la suite s’en venir décorer le mur d’enceinte. Les personnages masqués, qu’ils soient nains ou de plus grande taille, portent des braguettes, une pièce de tissu rembourrée recouvrant les parties génitales, qui pouvait prendre d’impressionnantes proportions valorisant le membre viril et par là même la puissance sexuelle de leurs possesseurs. L’extravagance sexuelle est partout, elle donne dans l’emphase comique sans pour autant sombrer dans la vulgarité. C’est toute la bouffonnerie burlesque et grotesque du comique carnavalesque des carêmes prenants. Ces énormités côtoient cependant l’expression exacerbée des sentiments les plus délicats. Aux côtés des grivoiseries, les récitatifs évoquent l’amour éperdu, les affres de la passion non partagée, le désir de mort, l’abnégation. le sens du sacrifice ou le deuil.
La costumière Corina Gramosteanu rend brillamment compte tant du foisonnement des costumes et des masques carnavalesques que de la somptuosité des costumes de cour, particulièrement des costumes d’apparat du doge.

Leonardo García–Alarcón et la Capella Mediterranea ont livré un travail d’orfèvre dans le rendu d’une partition encore marquée par les raffinements des lignes mélodiques et par l’importance restée prépondérante des récitatifs à une époque où les opéras accordaient une place de plus en plus importante aux arias. Les récitatifs puisent dans le fonds musical de la cantate et du madrigal, ils ont un caractère mimétique, ils s’ingénient à peindre de manière vibrante chaque idée que suggère le texte du livret. Les rares arias sont plutôt courts et ne recherchent pas la virtuosité. Cavalli a fait évoluer le recitar cantando des premiers opéras florentins vers une nouvelle forme de cantar recitando « à la vénitienne ». Il multiplie dans les scènes de courtes sections d’arie. Mélodiste raffiné et original, le compositeur ne s’adonne jamais à la virtuosité, mais assouplit son récitatif, propose des lignes perpétuellement mélodieuses tout en respectant les impératifs de la prosodie. Ses lamenti sont conçus de manière ingénieuse, il s’agit d’attirer l’attention vers l’action dramatique, la richesse des moyens musicaux est mise au service de l’étonnement et de l’émerveillement du public. Ainsi les récitatifs prennent-ils tout à coup une forme mélodique, répètent en séquence une même phrase, puis continuent à déclamer, ils deviennent alors des ariosos.
Leonardo García–Alarcón est un chef au dynamisme charismatique contagieux qui incite ses musiciens à un jeu très physique. Les musiciens accompagnent le jeu de leur instrument de tout leur corps, ils forment comme un essaim chantant et mouvant inspiré par les mélodies dont ils interprètent la puissance rythmique.

Pompeo Magno est servi par un plateau de treize chanteurs tous remarquables dont on finit par identifier les rôles sous les masques. L’esprit de troupe prévaut sur les excellentes performances individuelles. Le rôle-titre est admirablement interprété par Max-Emanuel Cenčić, qui est l’âme du Festival.
Il compose un Pompeo généreux, vieillissant et bonhomme, en concurrence avec le Scipione Servilio de Valer Sabadus avec qui il dispute la main de Giulia, la fille de Cesare (Sophie Junker), deux personnages qui rivalisent de politesses et d’abnégation.

La soprano argentine Mariana Flores donne une éblouissante Issicratea particulièrement saisissante dans l’expression de la fureur, pour laquelle elle semble prendre les traits d’une Méduse caravagesque avec des yeux exorbités de colère et une bouche vindicatrice.

Le contre-ténor autrichien Alois Mühlbacher fait des débuts bayreuthois acclamés en Farnace. Il se montre extrêmement touchant dans la belle phrase à 3 temps de style arioso par laquelle Farnace supplie son père Mitridate de lui laisser boire avant lui le poison.

Le ténor Valerio Contaldo dresse un Mitridate férocément jaloux et rempli d’une mâle assurance auquel il confère de sombres couleurs.

Le jeune contre-ténor italien Nicolò Balducci, très acclamé et primé dans les concours d’opéra, donne un Sesto d’anthologie avec une présence scénique incandescente et les souplesses d’une voix au timbre lumineux. Pourvu de telles qualités, le pauvre Sesto ne parvient cependant pas à séduire la très vertueuse Issicratea.
Deux rôles en jupons rivalisent pour la palme de la composition la plus hilarante : l’intrigante Arpalia du contre-ténor Kacper Szelążek, une dangereuse sorcière, et la drolatique Atrea du ténor de caractère Marcel Beeckman qui brûle les planches de sa présence incandescente.
Le public aux anges a réservé une standing ovation à cette production qui tutoie l’excellence, Avec des zélateurs comme Max-Emanuel Cenčić et Leonardo García–Alarcón on peut sans se risquer prédire des lendemains qui chantent aux opéras de Francesco Cavalli.
Luc Henri ROGER
9 septembre 2025
Direction musicale : Leonardo García–Alarcón
Mise en scène : Max-Emanuel Cenčić
Scénographie : Helmut Stürmer
Costumes : Corina Gramosteanu
Lumières : Léo Petrequin
Assistante mise en scène : Constantina Psoma
Dramaturgie : Max-Emanuel Cenčić & Fabián Schofrin
Pompeo Magno : Max-Emanuel Cenčić
Issicratea : Mariana Flores
Mitridate : Valerio Contaldo
Amore / Farnace : Alois Mühlbacher
Sesto : Nicolò Balducci
Giulia : Sophie Junker
Cesare : Victor Sicard
Claudio : Nicholas Scott
Scipione Servilio : Valer Sabadus
Crasso : Jorge Navarro Colorado
Delfo : Dominique Visse
Arpalia : Kacper Szelążek
Atrea : Marcel Beekman
Cappella Mediterranea Orchestre en résidence au Festival d’Opéra Baroque de Bayreuth 2025
Prochaines représentations
Les 12 et 14 septembre 2025 à l’Opéra des Margraves de Bayreuth.
À voir sur Arte Concert à partir du 17 septembre 2025
Et / ou en version concertante au Théâtre des Champs-Élysées le 1er octobre.