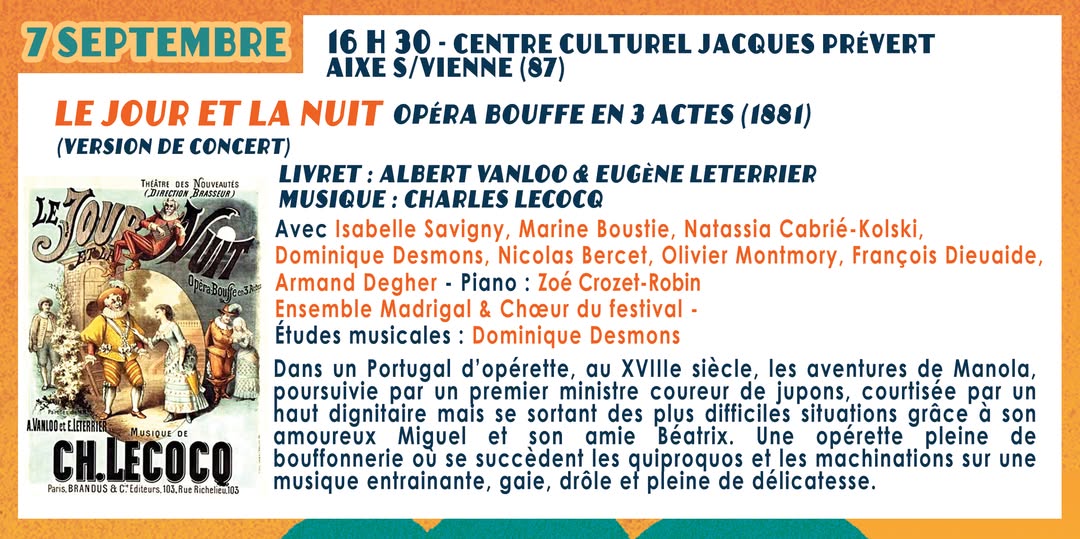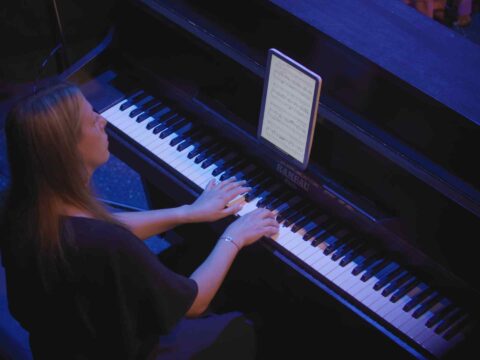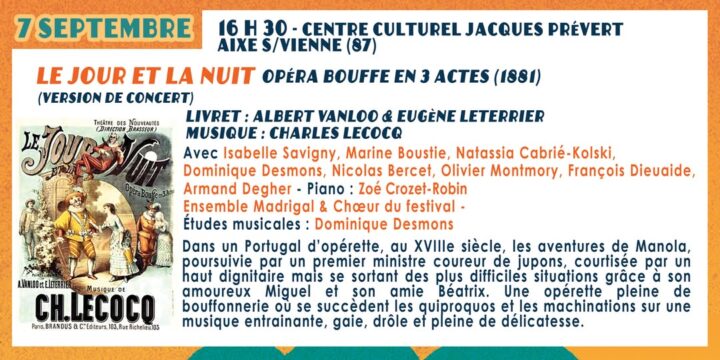Le Jour et la Nuit de Charles Lecocq (Magnac-Bourg, Haute-Vienne, Salle de fêtes / Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne, Centre Culturel Jacques Prévert)
C’est en version de concert qu’est donné dans deux communes haut-viennoises le Jour et la Nuit de Charles Lecocq.
Survol de la carrière de Charles Lecocq
Le Jour et la Nuit qui a été un grand succès (près de 200 représentations) ne faisait pas partie des premières œuvres du compositeur. La carrière de Charles Lecocq (1832-1918) débute en 1857. Son Docteur Miracle primé au concours organisé par Jacques Offenbach est bien connu. Ce sont, après 1870, les Cent Vierges (1872) et la Fille de Madame Angot (1872-73) qui le propulsent sur le devant de la scène. Viendra ensuite à partir de 1874 la longue série des ouvrages donnés pour la plupart au théâtre de la Renaissance qui en feront le musicien phare de l’époque. Giroflé-Girofla (1874), la Petite Mariée (1875) ou le Petit Duc (1878) sont de ceux là. Les librettistes les plus fréquents sont Eugène Leterrier et Albert Vanloo, ce qui donne à plusieurs de ses opéras-comiques un air de ressemblance. Après une courte pose Lecocq se tourne vers le théâtre des Nouveautés qui programmera le Jour et la Nuit (1881) et le Cœur et la Main (1882). La suite sera plus inégale, les créations étant plus espacées et moins triomphales, même si, parmi d’autres, la Princesse des Canaries, Ali–Baba ou le tardif Rose Mousse méritent toujours d’être écoutés. On notera la proximité amicale et professionnelle de Lecocq avec Saint-Saëns et Chabrier.
Focus sur la dramaturgie musicale du Jour et la Nuit
Acte I : des « préparations » à l’action
L’action se déroule au Portugal au XVIIe siècle. Braseiro, baron et gouverneur de province, attend l’arrivée de sa nouvelle épouse. Alors que son intendant Miguel règle les derniers préparatifs, lui-même est rappelé sur le front afin de repousser les Espagnols. Deux airs, un pour chaque personnage, ponctuent cette entrée en matière. Arrive, paniquée, Manola, l’amoureuse de Miguel ; elle a dû échapper au dévolu qu’a jeté sur elle le premier ministre du Portugal, le prince de Calabazas. Sa romance « Comme l’oiseau effarouché » ne manque pas de brio. Une première stratégie se met en place : faire passer Manola pour la future femme de Braseiro permettra de la soustraire au prince. Entrée justement de Calabazas qui reconnaît son donjuanisme invétéré et couplets à l’avenant « Les femmes, ne m’en parlez pas ! » Le prince est mis au courant de la situation dans un « morceau d’ensemble ». Retour inattendu de Braseiro qui a négocié son retrait de la guerre. Pour lui Manola est la baronne avec laquelle il se réjouit de convoler. Manola et Miguel ne voient pas comment se tirer du mauvais pas. Leur duetto « Tuons-nous » dit leur effroi, d’autant plus que don Degomez, le négociateur, se présente avec Béatrix la véritable baronne. Les deux jeunes femmes sont amies, ce qui permet de mettre en place le deuxième étage du stratagème. Jusqu’au départ du prince Manola passera pour l’épouse de Braseiro le jour, Béatrix le rejoindra dans sa couche la nuit. Après les couplets de Béatrix qui expriment une certaine appréhension, le final passe à l’exécution du stratagème qui jusqu’à la tombée du rideau semble bien fonctionner. Le numéro s’ouvre sur une prière à saint Michel chantée a cappella et reprise en coda avec l’orchestre.
Acte II : les matériaux de l’opérette classique
Après une romance de Miguel et des « aubades bouffes », une bonne moitié de l’acte revient sur la nuit de noces qui ne fut pas banale. On peut d’autant plus s’interroger sur cette obsession du thème qu’il est récurrent dans l’opérette de l’époque. Si les réponses faites par Manola à Braseiro restent évasives les questions n’en sont pas moins intrusives et suggestives. Le récit de la nuit est centré ici sur la chanson de l’épouse. Deux numéros y sont consacrés : le premier qui met en échec Manola, le second, un duo, où l’épouse de la Nuit double en coulisse l’épouse du Jour. Les chansons relativement exogènes déplacent dans l’acte celles qu’on trouve dans de nombreuses opérettes classiques en abyme dans les finals. Leur touche grivoise compensait souvent ce que l’ordre moral imposait dans la construction de l’intrigue et la caractérisation, voire la typologie, des personnages.
L’action repart avec deux « morceaux d’ensemble » qui se succèdent. Le premier est consacré au départ attendu de Calabazas, Manola n’étant plus « disponible ». Dans ce numéro se trouve un des tubes le l’opérette : « Les Portugais / Sont toujours gais ! » C’est dans le texte parlé immédiatement à la suite de ce numéro que le prince avoue à Braseiro son amour pour Manola. Le second ensemble « Qu’on m’apporte mon parasol » contient un coup de théâtre : le prince « flashe » sur Béatrix. Il s’agit alors pour cette dernière comme pour Manola de se débarrasser du premier ministre. Manola prend en mains la situation en se rappelant à Calabazas qui se remet à la courtiser. La jeune femme va parvenir à contenir son séducteur en l’emprisonnant dans un pigeonnier. Un duo, suivi du final, donne gain de cause à tous.
Acte III : un véritable acte III
Le décor d’une auberge un peu interlope à la frontière tenue par Sanchette et Cristoval sert de cadre à plusieurs numéros sans lien avec l’intrigue. Un premier chœur, puis un second sous la forme d’un boléro, enfin les couplets de Sanchette étoffent le début de l’acte. Les deux couples parfaitement assortis arrivent. Les deux femmes sont déguisées : Béatrice a conservé sa mantille, Manola est en muletier. Le premier couple veut rentrer au château, le second fuir. Braseiro chante les couplets : « Je passais un jour dans la rue » ; Manola et Miguel un duetto « Nous sommes deux amoureux », Manola l’air du Muletier.
C’est ensuite l’arrivée de Calabazas et don Dugomez qui va précipiter les événements et provoquer les éclaircissements du dénouement. Miguel n’a pas enlevé la femme de Braseiro, mais est parti avec sa propre amoureuse. Quant à Braseiro, il se félicite de découvrir que Béatrix, présentée comme la femme de chambre, est son épouse. Bien évidemment Calabazas est floué. Le final est chanté ; il est précédé par le joli quatuor du « Jour et la Nuit ». Après quelques compléments sur l’intrigue est reprise la scie : « Les Portugais / sont toujours gais ! ».
Le Jour et la Nuit, une version concertante revisitée
La version de concert annoncée se fonde sur une formule très séduisante, celle qui prend la forme d’un enregistrement tel que ceux pratiqués par le Radio Lyrique de la fin de la guerre aux années 1970 (même s’il n’est pas procédé comme à l’époque à une captation séparée du texte parlé et des parties chantées). Le speaker qui lit les textes de liaison de Denise Vautrin revus par Dominique Desmons interprété par un impeccable Armand Degher est plus vrai que nature. Les coupures sont parcimonieuses et les chanteurs sans tomber dans la mise en espace ajoutent le jeu à la stricte interprétation des éléments chantés et parlés de l’opéra-bouffe.
Alors qu’on estimait en 1881 que le rôle de Manola était long et lourd, Marguerite Ulgade sa créatrice, venue de l’Opéra-Comique, étonna par la fraîcheur de sa prestation, l’enchaînement des nombreux numéros ne semblant pas lui poser de problème.

Isabelle Savigny qu’on a applaudie ces dernières années à la Follembûche dans tous les premiers plans est dans cette lignée. Elle donne la même impression de facilité, de spontanéité et de présence allant vers le public comme vers ses partenaires. Sa voix richement timbrée, souple, sa façon raffinée de dire les mots en font une interprète idéale pour l’opérette classique qui offre une grande variété de morceaux. Son magnifique air d’entrée « Comme l’oiseau qui fuit » est donnée avec une carrure d’opéra ; l’air suivant « Voyez, elle est charmante » se dote du même investissement. Les modalités différenciées de la voix, la diction parfaite, le sens de la mélodie comme du rythme donnent leur fonction performative et leur couleur aux interventions dans les ensembles, aux deux duos avec Miguel « Tuons-nous » et « Nous sommes deux amoureux », celui du serpent avec le prince Calabazas « J’ai vu le jour dans un pays » atteignant des sommets d’interprétation (et d’amusante contorsion!) comique partagés avec son partenaire Dominique Desmons. Elle n’est pas moins expressive dans les trois chansons exogènes de la nuit de noce ou dans le très beau quatuor final.
Miguel, son amoureux, est chanté par Olivier Montmory à la vocalité assurée, avec une solide voix de ténor d’opéra-comique qui ne se départit jamais des nuances et couleurs du seul rôle masculin vraiment lyrique de l’ouvrage.

La bonne idée de la distribution a été de différencier les deux clés de fa (Braseiro et Calabazas) correspondant dans leur écriture à des rôles bouffes. Les deux interprètes sont exceptionnels, tant par le jeu qui s’exprime même au concert que par la voix. Le prince Calabazas à qui revient les tubes de l’opérette (« Les femmes, ne m’en parlez pas ! », « Les Portugais / sont toujours gais », l’ensemble du parasol…) est interprété par Dominique Desmons moins dans dans la tradition d’un trial diseur que dans celle du ténor bouffe d’opéra-comique à la voix percutante et sonore, consubstantielle à la comédie dont les traits visent juste. Dans Braseiro Nicolas Bercet, sans céder sur le jeu du personnage dépassé, éberlué, mais sympathique, chante avec une réelle éloquence et puissance de voix un rôle qui compense l’absence d’un emploi de baryton classique dans la partition.

Le rôle de Béatrix est interprété par Marine Boustie qui elle aussi adapte le jeu rendu possible par le concert revisité aux airs parfaitement chantés. Le numéro « Certainement c’est bien charmant » est superbement enlevé, le lyrisme apparaît dans le duo du rossignol, comme les accents dramatiques dans les ensembles du deuxième acte.
Les trois autres interprètes dans des rôles plus courts n’ont pas été moins remarqués. Natassia Cabrié-Kolski est une Sanchette extravertie et vibrionnante, sensible aussi ; elle détaille son air « Mon cabaret » avec beaucoup d’esprit en le dotant d’une voix claire et bien projetée. Armand Degher fait contraster avec son speaker sérieux un Cristoval des plus bondissants. Quant à don Degomez, il est joué par François Dieuaide qui lui donne une tournure récurrente pleine d’un humour qui le fait exister.

Les chœurs associés de l’ensemble Madrigal et du Festival apportent une contribution musicale enflammée et pertinente, tandis que Zoé Crozet-Robin sait faire oublier l’orchestre en dotant son jeu pianistique cultivé des couleurs de l’opéra-comique.
Le concert a été longuement applaudi.
Didier Roumilhac
7 septembre 2025
Piano : Zoé Crozet-Robin
Manola : Isabelle Savigny
Béatrix : Marine Boustie
Sanchette : Natassia Cabrié-Kolski
Prince Picratès de Calabazas : Dominique Desmons
Don Braseiro : Nicolas Bercet
Miguel : Olivier Montmory
Don Degomez : François Dieuaide
Cristoval et le récitant : Armand Degher
Chœurs : Ensemble Madrigal / Chœur du Festival