Nouvel événement de rayonnement international 2024 à marquer d’une pierre blanche depuis La Vestale de Spontini à Paris en juin dernier : le Teatro Regio de Turin participe d’une façon singulière à la commémoration du centenaire de la mort de Puccini. Limitée quantitativement [NB : tout bonnement pour des raisons essentiellement liées à l’opportune pérennisation des législations nationales et traités européens relatifs à la protection des droits d’auteur !] la production puccinienne n’autorise guère les choix hors normes dans les programmations. Grâces soient néanmoins rendues aux théâtres et festivals qui, depuis janvier, tentent de redonner une chance, plus que justifiée, à La Rondine, Le Villi ou Edgar.

Pourtant, nous devons l’idée la plus originale tant que séduisante à Mathieu Jouvin, surintendant du Teatro Regio, qui a choisi de confronter la Manon Lescaut de Puccini avec celle d’Auber, ainsi qu’à la Manon de Massenet. Si les distributions divergent radicalement d’un titre à l’autre, une notable audace consiste à confier les trois opéras au même metteur en scène. Ces soirées fuyant les lieux communs attirent nombre de directeurs de maisons lyriques, autant que les plumes signant dans maints médias, faisant du Teatro Regio, en cette fin octobre, rien moins que « The place to be » !

24 Octobre : Manon Lescaut d’Auber
Faveur due aux hasards du calendrier, nous assistons aux représentations dans l’ordre chronologique des créations de ces trois œuvres. Opportunité bénéfique, autorisant une plus juste évaluation des critères esthétiques attachés à ces partitions, propice à mesurer leurs mérites respectifs loin de toute idée de comparaisons ou préférences subjectives. Car tout critique professionnel doit se garder des truismes inhérents à l’amateurisme arrogant.
À propos de celle d’Auber, le lecteur avisé comprendra aisément le trait saignant que nous voici contraint de décocher. L’incurie n’ayant, décidément, aucune limite, les entractes fournissent l’occasion d’entendre certains directeurs invités se surpasser en cuistrerie, dénigrant la valeur intrinsèque de l’œuvre d’Auber, qu’ils « découvrent » pour la circonstance [Sic !]. Mais de qui se moquent-ils ? Passe encore qu’ils soient incapables d’en déchiffrer la partition mais l’écouter s’inscrit depuis des lustres à la portée de tout le monde. Rappelons que, dès 1975, la pionnière intégrale discographique de studio dirigée par Jean-Pierre Marty chez EMI permettait d’appréhender cette composition dans les meilleures conditions. Ensuite, l’étape cruciale se concrétisa dans les représentations enclenchées à l’initiative du regretté Pierre Jourdan, en coproduction / coréalisation avec le Théâtre impérial de Compiègne, la scène de Caen et la Salle Favart (où la captation de 1990 a permis l’édition récente d’un DVD). Vinrent ensuite les productions respectivement présentées au festival irlandais de Wexford en 2002, puis à Liège par l’Opéra Royal de Wallonie en 2016, dont les dissemblables qualités complétèrent la substance d’évaluation chez toute personne dotée d’un minimum de bon sens, les professionnels authentiques en tête. Monsieur Mathieu Jouvin, qui en fait partie, n’a donc pas hésité à offrir une nouvelle chance à cette brillante Manon Lescaut, au sujet de laquelle rien n’est plus stupide que d’avoir la « mémoire du futur ». Le résultat donne raison à sa courageuse détermination.

Où le principe d’une convaincante mise en abyme s’impose
Axant son propos général sur l’évolution du cinématographe jusqu’à 1960, Arnaud Bernard, inscrit cet opéra-comique tardif (1856) du catalogue d’Auber dans l’esthétique relevant du Muet. Dès l’ouverture, la projection de fragments du film When a man loves d’Alan Crosland (USA 1927, avec Dolores Costello et John Barrymore) apporte un plausible éclairage aux spectateurs néophytes. Puis, le principe d’une convaincante mise en abyme s’impose : dans un studio en fines structures métalliques soutenant d’amples surfaces de verre (évoquant à s’y méprendre celui d’un Georges Méliès), l’on tourne donc un film sur l’histoire de Manon Lescaut, d’après le roman éponyme publié par l’Abbé Prevost dès 17311. La gestique des interprètes adopte conséquemment celle des années 1920. Les costumes XVIIIème siècle s’extraient de la gangue allant du noir au blanc en passant par tout un camaïeu de gris pour les équipes de tournages et les curieux des alentours, s’ouvrant aux tons pastels (vert amande, bleu et rose pâles…etc.) pour les chœurs ou certains protagonistes. Résultat magnifique, très esthétisant, convaincant de bout en bout. Seuls trois regrets sont à émettre : d’abord faire du Marquis d’Hérigny un pantin plutôt grotesque, loin du personnage fascinant construit autour de René Massis en 1990, qui alternait aspects inquiétants à la Choderlos de Laclos et une confondante noblesse d’âme (bien réelle dans le livret) ; ensuite une interrogation : pourquoi la mise en abyme disparaît-elle à compter du III en Louisiane ? Mystère ; enfin laisser le décor quasi constamment ouvert à l’arrière-plan aux actes précédents constitue un cruel handicap acoustique pour les solistes qui, privés de renvoi, peinent souvent à passer la rampe.

Tel est le cas pour la Manon de Madame Rocío Pérez, dotée d’un registre aigu assez flamboyant mais dont les médium et grave exigent un gros effort d’attention pour en ouïr les produits. Toutefois, la cantatrice gagne en étoffe au fil des actes, chauffant progressivement sa voix, assumant ses solos (dont la fameuse Bourbonnaise / air dit « de l’éclat de rire« ) avec cran, convaincant davantage dans la ductilité (trilles et notes piquées impeccables) que dans le lyrisme. Ce nonobstant, alliés à plusieurs sons filés de belle facture, des phrasés soignés la font accéder à des démonstrations bouleversantes d’émotion au III. Ajoutons que sa bonne conduite de la ligne lui permet même un fort estimable duo avec d’Hérigny au II.
Ce personnage fondamental (conçu pour les imposants moyens d’un Jean-Baptiste Faure2), n’est ici qu’honnêtement servi par Armando Noguera, lequel doit lutter contre la servitude acoustique susmentionnée, l’amenant parfois à user fatalement du parlando. Néanmoins, si l’on doit calibrer les appréciations compte-tenu du contexte, l’interprète ne démérite jamais, ce qui est tout à son honneur, assumant scrupuleusement sa partie jusqu’à son terme.

Sébastien Guèze, élément le plus idiomatique dans cette distribution internationale
Élément le plus idiomatique dans cette distribution internationale, Sébastien Guèze surpasse les Des Grieux d’Auber entendus précédemment, en aisance, en conduite châtiée du legato, faisant seulement regretter que le rôle soit si peu valorisant et excessivement court.
S’agissant des emplois secondaires, l’on estampille avant tout la Marguerite prometteuse campée par Lamia Beuque, tandis que l’efficient Gervais d’Anicio Zorzi Giustinani pèche surtout par un rétrécissement du spectre dans le registre supérieur. Quand Francesco Salvadori déploie d’appréciables qualités de timbre et une confortable largeur sonore en Lescaut, que Guillaume Andrieux campe Renaud en offrant les mêmes qualités en diction, il devient plus difficile d’accepter le français excessivement approximatif offert par Paolo Battaglia en Commissaire Durozeau. L’impact que devraient revêtir les interventions d’un personnage aussi glaçant s’en trouve inopportunément amoindri. À l’inverse, Manuela Custer constitue un luxe, sous-distribuée qu’elle se trouve en Madame Bancelin.
Un petit décalage épisodique mis à part, les chœurs maison préparés par Ulisse Trabacchin se font remarquer par leur présence incisive autant que des coloris variés ou un sens rythmique aiguisé (le second tableau du I, chez Bancelin, les portant au zénith sur ce dernier plan).

Bien que ne possédant pas dans son ADN les spécificités stylistiques d’Auber (rarement représenté céans ces cinquante dernières années), l’Orchestre du Regio fait preuve d’une stupéfiante capacité d’adaptation au répertoire d’opéra-comique, déjà constatée dans La Fille du régiment de Donizetti au printemps 2023. Maître d’œuvre dans cette réalisation sonore, Guillaume Tourniaire croit en la partition, la servant avec conviction et panache dès son irrésistible ouverture. Par ailleurs, il sait faire ressortir toutes les finesses harmoniques d’une instrumentation légère (rappel : l’antonyme de lourde !) mais jamais primaire, même dans les sections les plus pétillantes. Outre un dynamisme comme un brillant des grands soirs, une sensibilité jamais affectée, le chef atteint des sommets dans l’acte conclusif en Louisiane. D’impressionnants trémolos ou l’expansion majestueuse des pupitres de cuivres instaurent autant de qualités rappelant avec beaucoup d’à-propos l’admiration de Richard Wagner pour Auber.
À noter que si l’on a taillé dans les dialogues parlés, la partition reste préservée pour l’essentiel, à l’exception du III, où la scène introductive subit des coupures – dont la Chanson créole, réduisant le personnage de Zaby à presque rien ! – trouvant probablement leur source dans les craintes d’une hypothétique réaction wokiste…
Pour sa création locale, la Manon Lescaut d’Auber aura bénéficié d’incontestables atouts, générateurs d’un accueil enthousiaste prodigué par un public ce soir très chaleureux.
25 Octobre : Manon de Massenet

Moins de six semaines pour monter de front trois ouvrages aussi exigeants relève de la performance pour Arnaud Bernard. Seul protagoniste commun aux volets de cette trilogie, le metteur en scène français livre sa relecture la plus poussée dans la Manon de Massenet. Tuilant adroitement son déroulement avec le film La Vérité de Clouzot (1960), il rebat les cartes, transformant donc l’héroïne en l’incarnation du personnage de Dominique Marceau par Brigitte Bardot, dont la cantatrice devient le clone, coiffure « choucroute » incluse. Entre les tableaux, moult séquences de ce film-clef appartenant à la « nouvelle vague » sont projetées, tandis que l’élément principal du décor (avantageusement moins ouvert sur l’arrière du plateau que pour Auber) montre une salle de tribunal stylisée mais exhaussée de façon surréaliste, écrasant la victime d’un engrenage fatal, comme dans la Mary Stuart réalisée par John Ford avec Katharine Hepburn (1936). Au risque de vous surprendre, votre serviteur estime qu’à cette aune, l’inégal livret de Meilhac (qui fit tellement mieux par ailleurs) prend un sacré coup de jeune. Sur ce point, nous revient en mémoire la vive réplique de Massenet à la question du librettiste « C’est [une] Manon Lescaut que vous voulez ? » : « Non ! Manon tout court ; Manon, c’est Manon ! ».

Cela fonctionne plutôt bien, jusqu’aux deux derniers tableaux où, patatras, tout bascule
Acceptons donc, avec un esprit ouvert, que le personnage devienne une jeune femme dévoyée quelconque aux yeux de la société volontiers pudibonde ou implacable de 1960. Force est d’admettre que Manon parmi les « blousons noirs » ou vedette d’un défilé de mode façon Christian Dior (se substituant au Cours-la-Reine), cela fonctionne plutôt bien. Oui… jusqu’aux deux derniers tableaux où, patatras, tout bascule, hélas, dans les errements générateurs d’un ennui profond. L’hôtel de Transylvanie devient un tripot clandestin propice au stupre, Guillot de Morfontaine y imposant, seul ou en groupe, plusieurs sévices sexuels à Manon, atrocité bucco-génitale incluse. Erreur et détournement total de sens, puisque la force dramaturgique s’appuie d’abord sur l’incapacité constante de cette véritable ordure de Guillot à pouvoir satisfaire sa lubricité avec l’héroïne, l’amenant même à trouver le prétexte à son arrestation et ce qui s’ensuit. Enfin, montrer le suicide chez Clouzot en amont de la mort chez Massenet corrompt toute logique. Le mieux est l’ennemi du bien. Dommage.

Où la distribution vocale constitue le maillon redoutablement faible du triptyque
Ces divagations qui altèrent la démarche – jusqu’alors si intelligente – d’un disciple de Nicolas Joël pourraient se trouver compensées par une exécution musicale « di primo cartello« . Hélas, nous sommes loin du compte, la distribution vocale constituant le maillon redoutablement faible du triptyque. Dans le rôle-titre, Ekaterina Bakanova3 se démène tant qu’elle peut, avec générosité, sans pouvoir surmonter ses inadéquations, techniques autant que stylistiques. Le volume surabonde mais le registre aigu surexpose les stridences à foison (comparativement, feu Beverly Sills – autrefois si injustement dénigrée – paraît d’un moelleux infini !). Quant à la ductilité et à la netteté, autant avouer qu’elles frisent la mise en berne (la grande scène du Cours-la-Reine en souffre à l’envi). L’on en vient à se poser une question embarrassante : n’y aurait-il pas une erreur d’orientation typologique chez la cantatrice, peut-être soprano dramatique qui s’ignore ? Le tableau de Saint Sulpice le laisse entrevoir. Quoi qu’il en soit, une sérieuse reprise en mains s’impose si elle veut durer.

Même navrant constat pour le Des Grieux signé par Atalla Ayan. L’idiomatisme modeste dont il fait preuve ne saurait constituer son principal défaut, dans la mesure où l’ensemble du casting manque singulièrement de bons francophones. Non, les principaux obstacles proviennent d’un triste prosaïsme dans l’expression, d’un timbre privé de séduction, sans omettre une difficulté souvent insurmontable rencontrée dans le respect des nuances indiquées. La typologie si particulière du Des Grieux de Massenet relève d’un ténor demi-caractère raffiné, ponctué d’éphémères épanchements lyriques fervents. Or, tout ceci échappe à un interprète vaillant mais sans charme, étranger à l’esthétique d’une écriture complexe, terriblement exigeante, où s’illustrèrent Nicolaï Gedda, Alain Vanzo ou Alfredo Kraus.

L’entourage des principaux protagonistes ne présente qu’un chanteur à la hauteur des enjeux : Björn Bürger, Lescaut ad hoc, mobile scéniquement, soyeux autant que vaillant dans l’émission voire poète (son « Ma Rosalinde » s’avère exemplaire à ce titre).
Vétéran du plateau, Roberto Scandiuzzi sait trop combien nous l’apprécions depuis ses débuts pour prendre ombrage d’un constat patent : le Comte Des Grieux, baryton-basse malcommode à gérer (pire que Phanuel dans Hérodiade) pour une basse noble, s’inscrit dans les plus périlleuses évolutions qu’un chanteur ayant toujours éprouvé des difficultés à placer ses aigus puisse affronter. Reste une largeur peu commune et une présence imposante, en dépit des outrages du temps, lui permettant de conduire l’ensemble « Oui, je viens t’arracher à la honte » en faisant encore forte impression. Vivement que nous puissions le retrouver dans un emploi se situant au cœur de ses meilleures notes.
L’ensemble des comprimari laisse franchement à désirer. Thomas Morris frise le malcanto en Guillot de Morfontaine, emploi de trial qu’il transforme ici en Spieltenor à l’allemande, proche de Mime dans Rheingold et Siegfried. Le confidentiel Bretigny d’Allen Boxer atteint les limites du perceptible dans un aussi vaste vaisseau que le Regio. Seule la Javotte de Marie Kalinine sauve la mise dans le trio des gourgandines, tandis que l’on remarque, pour sa belle prestance, l’hôtelier d’Ugo Rabec parmi les divers petits emplois.
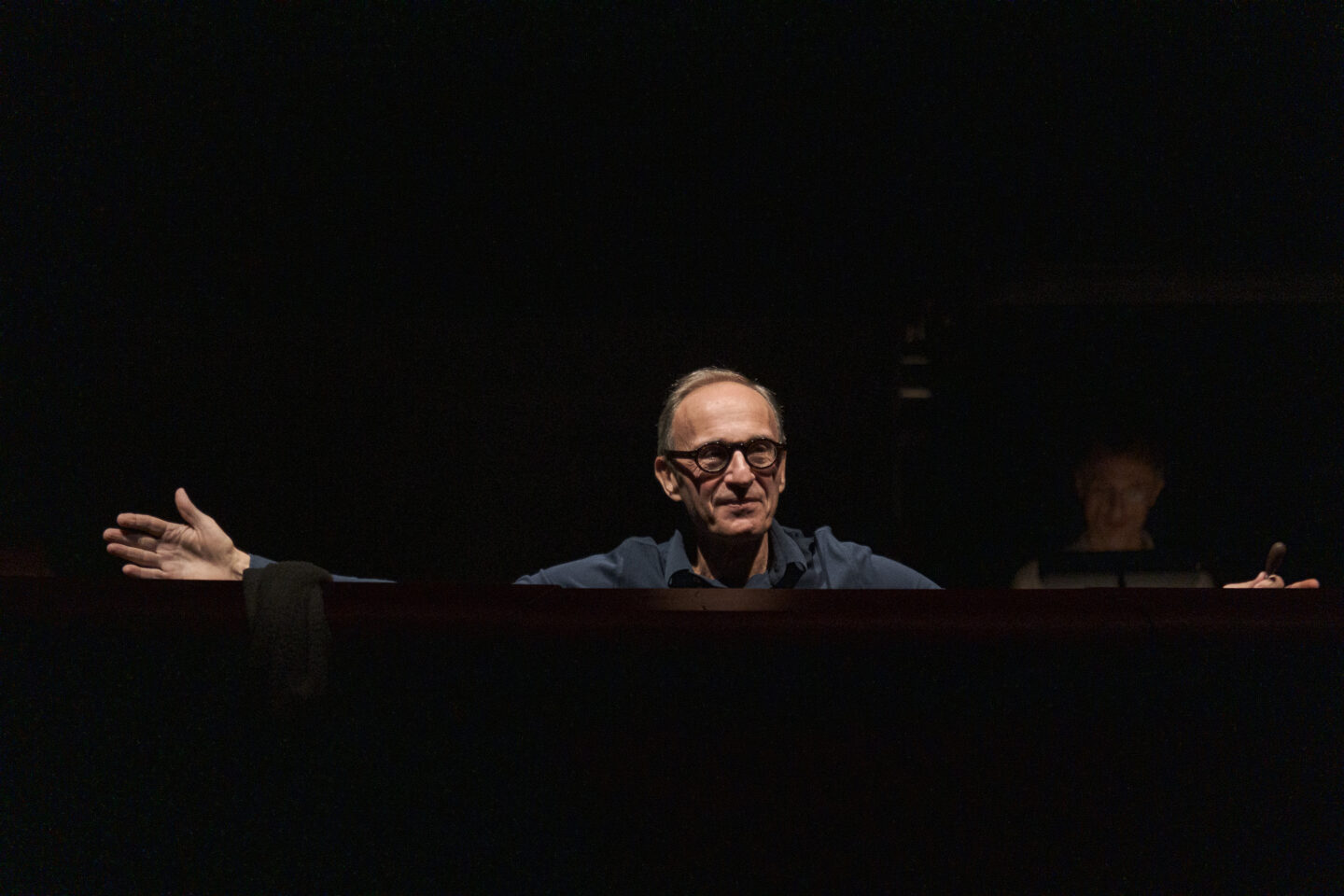
Où la direction musicale appropriée d’Evelino Pidò sauve l’essentiel
Dans ce contexte problématique à plus d’un titre, la direction musicale appropriée d’Evelino Pidò sauve l’essentiel. Parfois un peu enclin au clinquant, il architecture au mieux le déroulement d’une partition bien maîtrisée, donnant souvent libre cours aux effets passionnés qu’on lui connaît. Pour une fois, on attendrait même de lui un surcroît d’effervescence à Saint Sulpice, où le modèle offert par Julius Rudel demeure insurpassable4. Sinon, question intégrité l’on peut, certes, déplorer l’omission du ballet mais davantage encore quelques coupures, notamment celles affectant Guillot de Morfontaine, alors que son arioso dit « du Régent », si souvent écarté, se trouve ici réhabilité d’une façon totalement inattendue.
Fort heureusement, les chœurs maintiennent, eux aussi, haut le pavillon, en apportant une dignité certaine à la partie vocale d’une soirée particulièrement erratique, la moins satisfaisante sur les trois auxquelles nous assistons.
26 Octobre : Manon Lescaut de Puccini

Après cette regrettable erreur de parcours, très pardonnable compte-tenu d’un projet aussi ambitieux, la conclusion du cycle frise l’apothéose avec l’opéra puccinien, créé précisément à Turin en 18935. Ayant pu voir les deux productions somptueuses données sur cette même scène du Teatro Regio dans les années 1980 et 1990, il nous faut juste effectuer un petit effort pour entrer dans un propos situé aux antipodes d’un historicisme enchanteur. Cette fois, Arnaud Bernard opte pour l’insertion dans l’esprit des films français produits entre 1930 et 1950, avec maintes projections d’extraits ou citations visuelles des Enfants du Paradis ou Quai des brumes de Marcel Carné, Remorques de Jean Grémillon et bien d’autres références, comme La Bête humaine de Jean Renoir.

La meilleure direction d’acteurs sur l’ensemble du triptyque et une beauté plastique incontournable
Cela chemine plutôt bien, avec quatre dispositifs scéniques renvoyant cette fois les voix vers la salle, les chanteurs n’ayant pas à s’épuiser en vain. Si l’acte I n’est en rien mémorable, le II s’avère quasi exemplaire, avec la meilleure direction d’acteurs sur l’ensemble du triptyque et une beauté plastique incontournable. Géronte y organise une réception costumée rendant hommage à la Commedia dell’arte tout en réservant à Manon un habit stylisé de Colombine provoquant l’étrange sensation d’un télescopage entre deux univers picturaux : le futurisme d’un Fortunato Depero et l’art optique d’un Victor Vasarely. Splendide !
Seules infimes réserves : Manon abat ici (acte vraiment superflu) Géronte de Ravoir au pistolet, tout comme celle de Massenet pour Guillot de Morfontaine précédemment. À l’instar de la production lyonnaise en 2010 (Lluis Pasqual) l’acte III souffre d’un déficit en clarté sur la destination des prisonnières (comment le régime de Vichy pourrait-il les envoyer aux Etats-Unis ?). Quant au IV, après une trop longue séquence (montage avec réitérations) d’images empruntées à Remorques en guise d’intermède sensé évoquer la traversée tempétueuse de l’Atlantique, l’accumulation devient saturation exaspérante en projetant surabondamment la conclusion tirée de la Manon de Clouzot avec Cécile Aubry et Michel Auclair (1949).

Véritable révélation, Erika Grimaldi possède tout pour incarner l’héroïne puccinienne
Des trois distributions, la présente se hisse sans peine au sommet du podium. Véritable révélation, Erika Grimaldi possède tout pour incarner l’héroïne puccinienne, à l’exception d’un trille peu assuré. Sinon, tout séduit : « In quelle trine morbide » révèle un lyrisme ardent conjugué à une sensualité inaccoutumée, un sens des mots, une mise en relief du texte sans faire pour autant un sort à chaque syllabe. Tout respire le bon entendement. La tessiture longue épate, avec trois registres parfaitement soudés, dont un grave exceptionnel et non retenu, profitant à « Sola, perduta abandonnata » voire à tout l’acte IV. Actrice toujours juste, Madame Grimaldi fait preuve tant de vivacité ou pétulance que d’engagement dramatique. Il conviendra désormais d’étudier avec attention son évolution de soprano grand-lyrique spinto, qui pourrait la conduire sur les traces d’illustres devancières, l’inoubliable Renata Scotto en tête. Une chose est sûre : la cantatrice distribuée dans Puccini se classe, objectivement, comme la meilleure des trois Manon entendues, toutes typologies confondues.

Malgré des duos transcendés par sa présence irradiante, l’on éprouve moins d’enthousiasme à l’égard d’un partenaire un cran en-dessous, bien qu’excellent acteur. Véritable « pétoire » dans le lexique familier des coulisses d’opéra (!), Roberto Aronica se montre prodigue en décibels jusqu’à la monochromie. Passant souvent en force (le raffinement ne constitue pas sa vertu princeps), la distinction timbrique lui fait défaut et, quarante ans après avoir admiré le valeureux autant que suprêmement élégant Nicola Martinucci dans le rôle sur cette même scène, il faut vraiment s’efforcer d’oublier le passé pour dénicher les qualités chez son successeur. La principale : une générosité qui finit par forcer la sympathie, lui permettant un partage mérité du triomphe avec sa partenaire au rideau final.

Prestation orchestrale rayonnante, avec des cordes graves en pole position
En revanche, aucune réserve sur l’excellent Lescaut incarné par un Alessandro Luongo dynamique en diable, cauteleux à souhait, élevant avec esprit l’abjection au niveau des beaux-arts, d’une décontraction scénique et musicale qui fait l’étoffe des chanteurs aguerris. Cette séduction vocale ne constitue pas l’apanage d’un Carlo Lepore un peu rocailleux en Géronte de Ravoir. Pourtant, il convainc par sa projection et son articulation exemplaires autant qu’un jeu (et un maquillage) évoquant le Zabel joué par Michel Simon dans Quai des brumes.

S’agissant des comprimari, nous déplorons vivement deux choses : d’abord que l’Edmondo si musicalement attrayant, quasi belcantiste, délivré par Giuseppe Infantino soit si souvent mal placé en scène (sur une galerie, en arrière), ce qui amoindrit la portée de sa prestation ; ensuite, que Reut Ventorero en Musico soit soumise à un tempo pressé par le chef, gâchant une prestation d’une totale pureté6. Félicitations aussi à Didier Peri, d’une saillance stupéfiante en Maître de Danse comme en Allumeur de réverbère, autant qu’à Lorenzo Battagion, d’une formidable autorité dans la phrase capitale confiée au bienveillant Commandant du navire.
Des trois opéras, celui-ci demeure l’étape qui s’inscrit viscéralement dans les gènes des forces maison. Les chœurs s’y montrent réellement époustouflants, d’une puissance contrôlée phénoménale, attestant plus qu’ailleurs du magnifique travail accompli avec Ulisse Trabacchin.

La prestation orchestrale rayonnante, avec des cordes graves – un des meilleurs pupitres de cette phalange – en pole position, pourrait atteindre la perfection si Renato Palumbo retenait davantage les tempos, trop souvent hâtifs, voire précipités. Cependant, difficile de faire mieux question rutilance au niveau des cuivres ou d’obtenir plus de velouté de la part des bois, tous en grande forme. Ajoutons une mise en valeur exceptionnelle des contrechants instrumentaux, révélant mieux que d’ordinaire la gestion contrapuntique de Puccini, ainsi qu’un sens affûté d’un vrai théâtre phonique, replaçant opportunément la fosse à l’épicentre du discours.

Espérons que l’opération sera reconduite par l’actuelle direction éclairée du Teatro Regio
Au bilan, en dépit des réserves émises, l’on peut dire que monter concomitamment trois ouvrages aussi lourds relève de l’exploit. En outre, l’expérience passionnante, fascinante, à laquelle nous avons eu le privilège d’assister mérite un retentissement et une renommée à l’échelle internationale. Elle nous a rappelé avec émotion l’âge d’or de ce théâtre qui, dans les années 1980, alternait systématiquement deux titres, servis par des distributions fastueuses, attirant des mélomanes de toute l’Europe à Turin, entraînant alors diverses retombées économiques pour la ville. Espérons que ce type d’opération sera reconduite par l’actuelle direction éclairée du Teatro Regio. Quelques rumeurs circulent à propos d’un projet similaire à l’horizon 2026. L’on nous permettra une humble suggestion, qui aurait un gros avantage économique. La mémorable production maison de Un ballo in marchera de Verdi, magistralement dirigée en mars dernier par Riccardo Muti, pourrait faire l’objet d’une reprise et constituer le foyer d’une nouvelle trilogie à la thématique cohérente, comprenant le Gustave III d’Auber et Il Reggente de Saverio Mercadante, opéra du plus haut intérêt, qui fut créé en 1843, précisément à… Turin !
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
1 Il n’est pas inutile de préciser qu’aucune des adaptations opératiques du sujet, jusqu’à Boulevard Solitude produit par Hans Werner Henze en 1952, ne prétend en traiter l’exhaustivité des épisodes et péripéties.
2 Rappel : le légendaire baryton français, digne héritier de Paul Barroilhet, fut – entre autres – le créateur de : Hoël dans Dinorah ou le pardon de Ploërmel de Meyerbeer, Hamlet d’Ambroise Thomas (rôle-titre) et le Marquis de Posa dans Don Carlos de Verdi.
3 Très estimable Anaï dans Moïse & Pharaon de Rossini à Lyon en janvier 2023 ; voir : https://resonances-lyriques.org/moise-pharaon-de-gioacchino-rossini-opera-de-lyon/
4 À ce titre, tendez l’oreille vers sa péroraison dans la gravure EMI-Angel de 1970 avec Sills et Gedda, rééditée sur CD par DGG en 2004.
5 Le 1er février 1893 au Teatro Regio, précédant de huit jours la création du Falstaff de Verdi à la Scala de Milan. Cet isochronisme fit surnommer Puccini « L’héritier de la couronne ».
6 Rappel : la mélodie est une adaptation de l’Agnus Dei concluant la Messa di Gloria achevée par Puccini en 1880.
Équipe artistique :
Mise en scène : Arnaud Bernard
Assistant : Yamal das Irmich
Décors : Alessandro Camera
Costumes : Carla Ricotti
Lumières : Fiammetta Baldiserri
Video : Marcello Alongi
Directeur de scène : Antonio Stallone
24 Octobre : Manon Lescaut d’Auber
Direction musicale : Guillaume Tourniaire
Chef de chœur : Ulisse Trabacchin
Orchestra e Coro Teatro Regio Torino
Manon Lescaut : Rocío Pérez
Le Marquis d’Hérigny : Armando Noguera
Lescaut : Francesco Salvadori
Des Grieux : Sébastien Guèze
Madame Bancelin : Manuela Custer
Renaud : Guillaume Andrieux
Marguerite : Lamia Beque
Gervais : Anicio Zorzi Giustiniani
Monsieur Durozeau : Paolo Battaglia
Un sergent : Tyler Zimmermann
Un bourgeois : Juan José-Medina
Zaby : Albina Tonkikh
25 Octobre : Manon de Massenet
Direction musicale : Evelino Pidò
Chef de chœur : Ulisse Trabacchin
Orchestra e Coro Teatro Regio Torino
Manon : Ekaterina Bakanova
Le Chevalier Des Grieux : Atalla Ayan
Le Comte Des Grieux : Roberto Scandiuzzi
Lescaut : Björn Bürger
Guillot de Morfontaine : Thomas Morris
Monsieur de Brétigny : Allen Boxer
L’aubergiste : Ugo Rabec
Poussette : Olivia Doray
Javotte : Marie Kalinine
Rosette : Lilia Istratili
Un garde : Alejandro Escobar
Un autre garde : Leopoldo Lo Sciuto
Un marchand, Le portier de S. Sulpice, Une voix : Roberto Miani
M de Chansons, Second joueur : Franco Rizzo
M de Elixir, Un joueur, Premier joueur : Giovanni Castagliuolo
Cuisinier, Voix du camp, Un joueur : Andrea Goglio
Un commerçant : Junghye Lee
26 Octobre : Manon Lescaut de Puccini
Direction musicale : Renato Palumbo
Chef de chœur : Ulisse Trabacchin
Orchestra e Coro Teatro Regio Torino
Manon Lescaut : Erika Grimaldi
Renato Des Grieux : Roberto Aronica
Lescaut : Alessandro Luongo
Geronte di Revoir : Carlo Lepore
Edmondo : Giuseppe Infantino
Un allumeur de réverbères et le maitre de ballet : Didier Pieri
Une musicienne : Reut Ventorero
Sergent et aubergiste : Janusz Nosek
Le commandant du navire : Lorenzo Battagion
Madrigalistes : Pierina Trivero, Manuela Giacomini,
Giulia Medicina, Daniela Valdenassi






































![Teatro Regio Torino - Foto Andrea Macchia [DSC_0359] (1)](https://resonances-lyriques.org/wp-content/uploads/2024/10/Teatro-Regio-Torino-Foto-Andrea-Macchia-DSC_0359-1-540x360.jpg)

